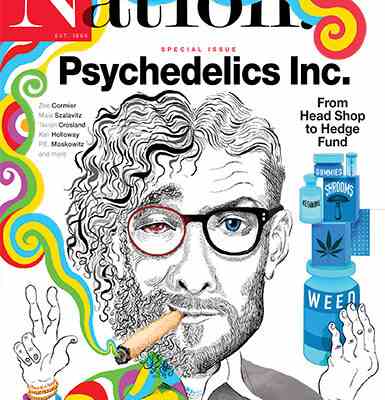Dans la nuit du 6 février, mon mari et moi avons pris un avion de New York à Zurich, en Suisse. Ce devait être notre dernier voyage ensemble et le premier que nous ayons fait depuis de nombreuses années. À bien des égards, c’était comme si nous avions pris tant de vacances au cours de nos 52 années ensemble : faire des plans, réserver des vols, trouver un hôtel – et un bon restaurant pour notre dernier repas. J’ai même plaisanté en disant qu’il devait mourir pour que nous puissions voler en classe affaires. Mais ce dernier voyage n’était pas une blague.
Nous voulions nous rendre en Suisse pour le décès de mon mari, une décision que nous avons prise ensemble des mois et des années plus tard. Une décision qui nous a obligés à lutter contre nos peurs, à peser nos options, à réfléchir à comment et quand le dire à nos enfants, à notre famille et à nos amis proches, une décision qui nous a finalement hantés à l’âge de six ans, décroissant la joie, augmentant dépendance et augmentation de la douleur.
Nous avons contacté à contrecœur un ami médecin pour voir s’il pouvait nous aider à nous procurer des barbituriques – Seconal ou Nembutal – mais on nous a dit qu’il les garderait pour lui s’il les obtenait. Nous avons essayé d’obtenir de l’oxycodone et du percocet d’amis qui avaient récemment subi une arthroplastie de la hanche, mais qui n’avaient aucune idée de la quantité à prendre. Le nombre de tentatives de suicide ratées ou infructueuses par surdose se compte en milliers. Obtenir du fentanyl dans le Bronx a été refusé parce que je craignais que ce ne soit ma chance d’être piégé par un flic infiltré. Mon mari a même envisagé de se couper les poignets, mais il ne pouvait pas tenir un rasoir ni entrer dans un bain chaud. Nous détestions tous les deux le fait de ne pas manger ni boire volontairement (VSED) – bien que nous le voyions comme une sauvegarde si tout le reste échouait. Puis nous avons découvert Dignitas, une organisation à but non lucratif en Suisse qui aide des gens comme nous qui ne peuvent pas être aidés aux États-Unis.
Ce n’était pas un processus facile, ni une décision facile. J’ai eu des moments de culpabilité pour ne pas m’être jeté sur la tombe et l’avoir supplié de changer d’avis. Il souffrait de sa propre culpabilité en voyant comment son déclin physique et sa dépendance croissante affectaient mon bonheur. Nous avons continué à vivre des vies de famille et d’amis, de bons repas, des visites de musées et de Central Park, des discussions sur la politique, des livres et des films. Mais alors que sa douleur augmentait et nous empêchait tous les deux de dormir la nuit, nos discussions sur nos enfants et tous les bons moments ont été remplacées par des pensées plus sombres que tout était sur le point de se terminer. Ce que nous ressentions tous les deux à notre manière était piégé – lui par son corps et moi par le sien et donc mon monde qui se rétrécit. Ce fut un processus long, angoissant et laborieux avec d’énormes obstacles. Lorsque nous avons enfin trouvé une issue, nous avons été énormément soulagés. Il nous a fallu cinq ans pour nous en sortir, non pas parce que nous pensions que mon mari irait mieux, mais parce que nous n’étions pas prêts à lâcher prise. Lorsque nous étions prêts, notre décision était basée sur l’amour, pas sur le désespoir, enracinée dans le respect et le soutien mutuel – ce qui décrit à peu près nos 50 ans de mariage. Six jours après que mon mari ait écrit cet essai, il était mort.
En 1970, je me suis cassé le cou dans un accident de surf. Ma moelle épinière était presque sectionnée et j’étais paralysée de la poitrine aux orteils. J’avais 36 ans et je me fiance. On m’a dit que je ne marcherais plus jamais, que j’aurais des enfants et que je vivrais plus de 50 ans. J’ai refusé d’accepter ce pronostic et j’ai appris à marcher avec le soutien, l’amour et la compréhension de ma fiancée et d’une thérapie physique intensive, marié, père de deux filles et grand-père de trois enfants. Les médecins qui m’ont soigné sont morts depuis longtemps, j’ai 87 ans au moment où j’écris ceci.
Après une carrière réussie, un mariage long et heureux et une vie profondément épanouie, l’impact de mon accident et les défis du vieillissement m’ont finalement rattrapé. Après plusieurs chutes, j’ai été confiné dans un fauteuil roulant. J’ai eu des douleurs intenses la nuit qui m’empêchaient de dormir. Je ne pouvais plus passer du fauteuil roulant au lit ou aux toilettes sans aide. Je ne pouvais pas me doucher ni m’habiller. Moi qui luttais toute ma vie pour mon indépendance, je ne pouvais plus prendre soin de moi et j’avais besoin d’aides et de ma femme pour me soutenir dans la vie de tous les jours.
Au cours des deux dernières années, j’ai vu mon corps s’effondrer autour de mon cerveau – mes mains sont devenues si faibles que j’ai eu du mal à écrire mon nom, à soulever une fourchette ou à tenir un rasoir. J’avais peur de devoir bientôt être nourri. Ma qualité de vie déclinait rapidement et je craignais de ne pas pouvoir contrôler ma vie ou ma mort si j’attendais trop longtemps.
Pour la deuxième fois, j’ai refusé d’accepter l’inévitable – une mort longue et douloureuse – et, avec les conseils patients et le soutien de ma femme depuis 50 ans, j’ai choisi le suicide.
Mais comment? Même dans les 10 États, dont l’Oregon, le Maine, le Colorado, le New Jersey et Hawaï, où le suicide assisté est légal, vous devez avoir un diagnostic de maladie en phase terminale (seulement six mois à vivre) et être résident de cet État.
Aucun médecin ne voulait m’aider à obtenir des pilules. Chaque recette est enregistrée sur Internet et fortement restreinte. Mon médecin généraliste a refusé de me donner bien plus que du Tylenol extra fort. Les drogues illégales sont trop risquées et presque impossibles à obtenir. j’ai suivi les performances Le manuel de la pilule pacifique et dernière sortie. Certains m’ont référé à des adresses en Chine et au Mexique qui semblaient sommaires et vers lesquelles je ne pouvais pas me rendre. Je ne savais pas comment accéder au dark web. Je ne connaissais aucun anesthésiste ou vétérinaire « amical » qui utilise volontairement des médicaments mortels dans sa pratique. Non pas qu’ils m’auraient aidé si je l’avais demandé.
J’ai fait des recherches sur le VSED, l’arrêt volontaire de manger et de boire, qui est légal aux États-Unis. Mais comme je n’avais pas de diagnostic incurable, je devais trouver un médecin qui serait prêt à prescrire des hospices, car je ne pouvais pas tolérer cette façon de mourir sans morphine ni anxiolytiques. Encore une fois, mon médecin généraliste a refusé de s’engager à commander des soins palliatifs le moment venu (la raison pour laquelle j’ai quitté son cabinet). Après une autre longue recherche, le psychiatre de ma femme m’a référé à un médecin compréhensif qui a accepté d’ordonner des soins palliatifs si je décidais d’arrêter de manger et de boire. En fin de compte, je ne pouvais pas supporter une mort prolongée (parfois jusqu’à trois semaines) où je dépérissais littéralement.
Puis j’ai découvert Dignitas, une organisation en Suisse dont la devise et la mission sont : « Live with Dignity. Mourez avec dignité. » Contrairement aux États-Unis, Dignitas propose le suicide assisté/assisté aux personnes qui ne sont pas nécessairement en phase terminale mais qui souffrent de problèmes de santé graves et débilitants. Ce n’est ni un processus facile ni un processus peu coûteux. J’ai d’abord dû soumettre une demande officielle, comprenant une lettre expliquant pourquoi je voulais mourir, des rapports médicaux indiquant le diagnostic et le traitement, des rapports médicaux détaillés et la preuve que je n’étais ni déprimé ni fou. Lorsque j’ai obtenu le feu vert, j’ai dû fournir un certificat de naissance, un certificat de mariage, une preuve de résidence et un dossier dentaire. Et bien sûr, je devais me rendre en Suisse où, à deux reprises, je serais interrogé par un médecin pour confirmer mon identité et établir que ma décision de mourir était prise de mon plein gré. J’étais libre de changer d’avis à tout moment, mais si je faisais le « compagnonnage », ce serait rapide et indolore.
Le coût comprenant le vol, les taxis, l’hébergement à l’hôtel pour deux nuits, les repas, etc. est d’environ 15 000 USD. Heureusement, je peux me permettre cet effort. Tout le monde ne peut pas.
J’ai dû choisir entre deux choix impossibles – continuer à dépérir ou mourir. Ma décision de « décrocher » et de laisser derrière moi des êtres chers, ma famille et des amis spéciaux est ma décision et la mienne seule. Je suis venu à cette élection avec un mélange d’angoisse et de soulagement. Cependant, j’aurais préféré mourir paisiblement dans mon propre lit entouré de ma famille. Je n’ai pas eu à parcourir près de 4 000 milles pour mourir dans un pays étranger.
Comme l’avortement, le droit de mourir est une question polarisante aux États-Unis. Elle contredit de nombreuses croyances religieuses et soulève des questions éthiques complexes. Mais pour moi ce n’est pas une question de religion ou d’éthique. C’est une question de respect et de libre arbitre. Si j’étais un chien vieillissant, incapable de marcher, de contrôler ses fonctions corporelles et souffrant beaucoup, je serais « euthanasié ».
Il y a quelque chose qui ne va pas quand un chien est traité plus humainement qu’un humain. Malheureusement, c’est le cas aux États-Unis aujourd’hui.
Le 9 février, mon mari est décédé paisiblement et sans douleur dans mes bras avec une fille à ses côtés. Juste avant de s’endormir pour la dernière fois, il a joyeusement exprimé son appréciation pour sa vie, son amour pour moi, ses enfants, petits-enfants, amis et son travail. Puis il bâilla un énorme bâillement, presque comme un bébé. C’était une mort douce. Une mort digne. Sa décision de choisir comment et quand il voulait mourir et ma décision de le soutenir ont été notre dernier cadeau d’amour l’un pour l’autre.