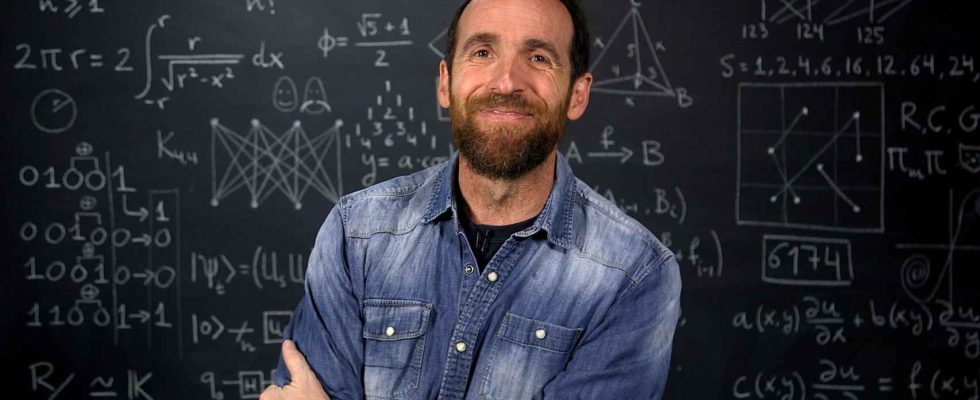Eduardo Saenz de Cabezón (Logroño, 1972) est un élément multiforme, indéfinissable et en constante transformation dans le scénario de la science espagnole. Il combine son travail de chercheur dans le domaine de l’algèbre computationnelle au Département de mathématiques et d’informatique de l’Université de La Rioja avec son rôle de vulgarisateur auprès de centaines de milliers d’adeptes, comédien de monologues scientifiques et présentateur d’Órbita Laika. sur La 2. Transmettre Son appétit insatiable pour la connaissance et les méthodes qui guident son esprit toujours agité, c’est ce qui a motivé son dernier livre, Invitation à l’apprentissage [Penguin].
De la formation en cybersécurité à l’apprentissage de la danse salsa, en passant par la découverte de l’histoire d’Al-Andalus, Sáenz de Cabezón se fixera des objectifs personnels qui nous accompagneront tout au long du chemin. « L’apprentissage que nous exerçons en tant que personnes ne reste pas individuel. Une société dans laquelle ses membres souhaitent apprendre est meilleure. Et c’est une belle contribution au bien commun », déclare le mathématicien, que l’on reverra bientôt à l’antenne. « Cela me fait une grande joie de voir des contenus qui peuvent contribuer à notre épanouissement personnel et collectif en réussissant à la télévision. «
Est-il confirmé qu’élever notre niveau d’éducation et pratiquer nos capacités cognitives contribue à maintenir la santé tout au long de la vie ?
Oui, et je cite plusieurs études, comme une très célèbre menée auprès de religieuses aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Il a été démontré que mener une vie intellectuellement active est corrélé à la résistance aux symptômes de la maladie d’Alzheimer. Il ne suffit pas de l’éviter, mais cela peut le ralentir de 5 à 10 ans. Et il est de plus en plus évident que cela peut nous aider à éviter les maladies chroniques et à vivre plus longtemps en meilleure santé.
[Ésta es la matemática valenciana que usa la estadística para escapar de los zombis]
On pourrait dire que tout commence par la santé cognitive et que le reste vient plus tard.
Oui, car cela permet de prendre conscience et de s’engager envers sa santé physico-mécanique, quitte à se promener un petit moment chaque jour. Les institutions sont de plus en plus conscientes de l’importance d’en faire la promotion de manière continue et structurée. Presque toutes les universités espagnoles proposent déjà ce qu’on appelle « l’université de l’expérience », des « classes seniors »… Des formations pour les personnes au-delà de l’âge de la retraite, avec un grand succès, que les gens vivent avec beaucoup de joie et d’intérêt.
L’inverse dramatique serait celui des jeunes qui échouent dans leurs études et estiment qu’ils ne sont pas assez bons pour apprendre pour le reste de leur vie.
Oui, c’est le piège que réside l’échec de nos processus d’enseignement, quelle qu’en soit la raison. Cela nous fait penser que nous sommes incapables et c’est un cas rare où il y a réellement un handicap. Cela peut arriver, tout comme il y a des personnes qui ont d’extrêmes difficultés de mobilité, mais ce sont des cas très spécifiques. La réalité est que nous avons tendance à exercer nos capacités d’apprentissage un peu en dessous de ce qu’elles pourraient être réellement. Je crois que l’environnement familial est déterminant dès le plus jeune âge, car il donne suffisamment de stimuli à nos enfants. Et surtout, il est très important de parler de nos processus d’apprentissage.
Comment « l’anxiété » influence-t-elle l’apprentissage ? Certains d’entre nous se sentent incapables de faire des mathématiques, par exemple, tandis que pour d’autres, c’est la « beauté » qui s’adresse à eux.
Eh bien, beaucoup de gens voient non seulement la porte des mathématiques fermée, mais ils la voient aussi avec des pointes à l’extérieur et un panneau de danger. Cela a sûrement à voir avec la façon dont nous avons vécu les mathématiques pendant nos années scolaires. Mais on ne peut pas le réduire à cette phrase bien connue selon laquelle « les mathématiques s’enseignent mal ». Peut-être que nous nous basons trop sur le résultat et pas tellement sur le processus. Cela, combiné à cette croyance sociale que nous avons selon laquelle les mathématiques sont « compliquées », pour les « gens intelligents », génère ce type d’angoisses qui se nourrissent les unes des autres.
Le livre défend quelque chose qui est aujourd’hui quelque peu anathème : la mémorisation. Est-ce un outil pédagogique incontournable ?
Bien sûr, c’est un outil très valable. Cela rend nos processus beaucoup plus faciles. Chaque fois que je dois multiplier 7 par 5, je n’ai pas besoin d’ajouter sept fois cinq, je m’en occupe presque immédiatement. Mais on ne peut pas confondre mémorisation et compréhension. Et voici quelque chose que je considère comme très important : la manière dont nous abordons l’évaluation. Si l’on récompense la mémorisation de manière exclusive ou de manière privilégiée, on ne rend pas service aux élèves. En revanche, lors du développement de concepts créatifs, le matériel que nous allons utiliser est ce que nous avons stocké dans notre mémoire. Plus nous avons de carburant, plus les opportunités sont grandes.
Que répondriez-vous au reproche courant « pourquoi avons-nous besoin d’apprendre à prendre des racines carrées, si la majorité n’en aura jamais besoin » ?
On pourrait faire la même chose avec l’analyse syntaxique d’une phrase, non ? Nous utilisons quotidiennement des objets directs, indirects, circonstanciels, etc., mais nous ne pensons pas à la terminologie utilisée à l’école. Et tout ce que nous apprenons ne doit pas nécessairement avoir une application directe pour tout le monde. De plus, bon nombre de ces enseignements sont instrumentaux. Ils nous permettent de structurer la tête. Une opération aussi complexe que prendre manuellement des racines carrées nous entraîne à la rigueur, à la minutie, à la capacité de revoir nos erreurs, etc. Ce sont des valeurs positives que nous utilisons au quotidien, et nous valorisons. Les mathématiques sont pour cela un lieu privilégié car la vérité des résultats ne dépend pas de celui qui le dit, celui-ci a un certain sens de la justice.
Eduardo Sáenz de Cabezon (c) NA
Alors, ce qui peut échouer dans l’enseignement, c’est qu’il n’est pas transmis qu’ils nous inculquent une méthode pour décrypter la réalité ?
Oui, je pense qu’il est important de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Cela nous ferait prendre conscience des avantages de nombreuses choses que nous apprenons à l’école. Les mathématiques y sont peut-être plus sensibles, car nous les rencontrons rarement dans nos vies en dehors de la salle de classe. Ils se cachent derrière le fonctionnement de notre téléphone mobile, nos mots de passe, etc.
Et pourtant, nous vivons immergés dans un monde d’algorithmes qui influencent nos vies sans que nous nous en rendions compte.
Totalement, nous sommes dans un monde de plus en plus informatisé. Et une société ne peut pas se permettre une génération qui ignore le fonctionnement au moins élémentaire des algorithmes. Dans le cas contraire, nous sommes à la merci de ceux qui les connaissent. C’est comme lorsqu’il y a quatre siècles, seuls les riches ou les intellectuels apprenaient à lire. Aujourd’hui, nous savons que cela vous rend beaucoup plus gérable, plus manipulable. Et je crois que cette culture technologique est aussi une culture scientifique. Si vous connaissez les bases des réseaux sociaux, vous savez que la réalité n’est pas ce qu’elle paraît.
L’Espagne souffre-t-elle, comme on dit, d’annumérisme ? Avons-nous des capacités mathématiques inférieures à celles des autres pays ?
Non, je ne dirais pas que le numérotisme est plus grave que dans les pays qui nous entourent. Nous avons un très bon niveau de scolarité obligatoire. Il est vrai que les classements de type PISA nous placent parfois plus bas, mais c’est une autre raison d’avoir des connaissances mathématiques, de bien comprendre les données : si l’Espagne obtient un 9,7 mais est derrière ceux qui ont obtenu un 10 , c’est quand même un bon résultat.
Il écrit que « le professeur le plus drôle n’est pas forcément le meilleur. » C’est frappant, étant toi précisément un comédien et vulgarisateur viral.
L’humour est un très bon outil de communication ; il introduit une composante émotionnelle très utile pour établir des connaissances. Mais il existe de nombreux outils, techniques et ressources en matière d’enseignement. Et ce que disent les études, c’est que ce qui compte vraiment, c’est l’implication des gens. Le bon professeur est celui qui trouve le moyen de transmettre l’amour du savoir aux élèves. Si vous le faites par l’humour, tant mieux, si c’est aussi avec d’autres mécanismes. C’est le plus grand trésor que nous puissions emporter avec nous de nos années d’école, quelque chose qui nous servira tout au long de notre vie.
Il souligne également que, même lorsque nous apprenons pour le plaisir, nous avons besoin de critères d’évaluation pour évaluer les progrès.
Oui, et son manque peut aussi provoquer de la frustration. Lorsque nous prenons l’apprentissage au sérieux, nous devons être capables de transmettre les connaissances sous une forme « dense », disons, à travers notre cerveau, et de lui faire faire un effort pour les assimiler. Si nous n’appliquons pas l’auto-exigence, le processus se déroule de manière plus légère. Et si j’essaie d’apprendre mais que j’oublie tout, cela ne veut pas dire que je ne vaux plus la peine d’étudier, mais cela signifie probablement que je ne l’ai pas pris au sérieux. Et nous devons passer par ce type d’évaluations, d’examens ou d’efforts.
Que pouvons-nous faire pour améliorer notre capacité à apprendre lorsque nous cessons d’être jeunes et sentons que c’est difficile pour nous ?
De nombreux facteurs interviennent. La plasticité neuronale en est une, et elle n’est pas la même tout au long de la vie. Mais cela ne diminue pas autant qu’on le pense. Les capacités à 20 ans ne sont pas les mêmes qu’à 70 ans, mais en revanche il existe un autre facteur très avantageux : l’apprentissage préalable. Si une personne de 50 ans commence à étudier l’histoire d’Al-Andalus, comme je l’ai fait, ce sera beaucoup plus facile pour lui qu’un enfant de neuf ans car il a beaucoup plus de références. Vous avez pu visiter l’Andalousie, vous connaissez une partie de l’histoire de l’Espagne, vous disposez de bien d’autres lieux pour ancrer de nouvelles connaissances.
Il met également en garde contre la capacité de douter : si la curiosité est bénéfique, douter de tout et systématiquement est à la base du complotisme.
Oui et c’est très dangereux. C’est nier toutes les connaissances qui ont coûté tant de temps et d’efforts à acquérir et qui reposent également sur des bases très solides. Et cela semble aussi vous placer dans une sorte de supériorité intellectuelle, voire morale, sur les autres qui se laissent tromper. Mais la méthode scientifique est vieille de plusieurs siècles. Le doute doit servir de méthode d’apprentissage et non d’invalidation des connaissances. C’est absolument ridicule. Nous vivons à une époque de doute égoïste, une sorte de protestation contre le système dont la connaissance scientifique ferait partie. Nous confondons les options politiques et les solutions sociales avec la connaissance scientifique, et cela n’a rien à voir. La loi de la gravité ne dépend pas du parti qui gouverne.
À quoi attribuez-vous l’explosion du déni scientifique sur les réseaux ces dernières années ?
Je pense que cela vient d’une sorte de désenchantement à l’égard du système, que nous extrapolons à tout ce que nous identifions comme « la voix des puissants ». Cela a des conséquences psychologiques, car il y a des gens qui se sentent réaffirmés dans leur valeur personnelle lorsqu’ils ne sont pas d’accord, lorsque leur opinion va à contre-courant. L’individualité et l’originalité de la pensée, c’est bien, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de partager des connaissances communes.
Suivez les sujets qui vous intéressent