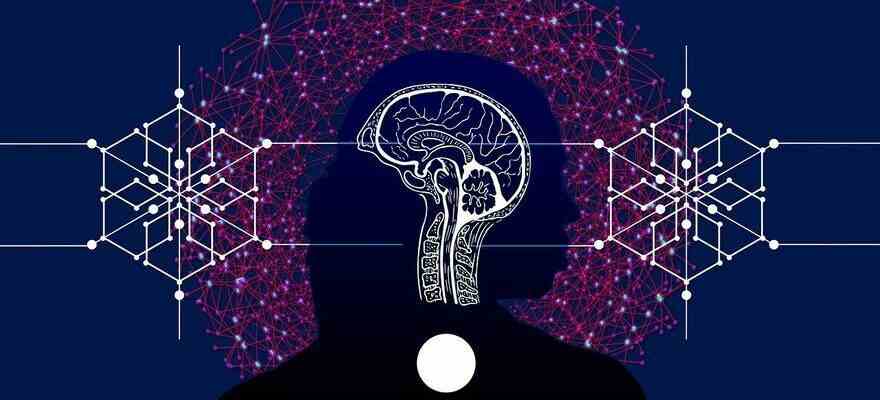Une vaste enquête a révélé que la plupart des opinions que les gens ont sur les questions scientifiques liées à la génétique ou aux vaccins ne sont pas toujours fondées sur des faits, mais sont tellement enracinées qu’elles obscurcissent leurs connaissances.
Des scientifiques du Royaume-Uni ont mené plusieurs enquêtes liées à la génétique, auxquelles plus de deux mille personnes ont participé.
Ils ont découvert que les personnes fortement opposées ou favorables à la génétique et à ses dérivés technologiques, tels que les vaccins ou les transgéniques, sont sûres de savoir et de comprendre de quoi elles parlent, mais en réalité ce n’est pas toujours le cas.
En même temps, ils ont observé que, chez les personnes qui s’opposent aux avancées scientifiques, la différence entre ce qu’elles pensent de la science et ce que la science dit réellement est pratiquement insurmontable.
Cependant, lorsque les gens sont neutres vis-à-vis des découvertes scientifiques, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni pour ni contre, ils ont moins confiance en leurs propres connaissances et sont plus ouverts à connaître et à comprendre la réalité. Les résultats de l’étude sont publiés dans PLoS Biology.
Enquête approfondie
Pour parvenir à ces conclusions, Cristina Fonsecade la British Genetic Society, avec des collègues des universités de Bath, Cambridge, Oxford et Aberdeen, ont mené une enquête auprès de plus de 2 000 adultes.
Les auteurs de l’article souhaitaient savoir non seulement ce que pensaient les gens qui s’opposent à la science, mais aussi ceux qui y croient passionnément.
Les chercheurs ont interrogé chacun sur leur attitude à l’égard de la science, sur leur certitude de la comprendre, et ont également évalué leur niveau réel de connaissances scientifiques.
L’enquête a également examiné les opinions sur les vaccins. Université d’Aberdeen.
confiance dans la connaissance
Les chercheurs ont également évalué la confiance des gens dans leurs propres connaissances, c’est-à-dire qu’ils ont mesuré la « compréhension subjective » de la science.
On a demandé aux participants comment ils évaluaient leur propre compréhension de l’actualité scientifique et leur niveau de connaissances scientifiques générales.
Les participants ont également répondu à quel point, selon eux, ils comprenaient les termes les plus courants en génétique : ADN, génétiquement modifié, sélection naturelle, PCR.
Les covariables de l’étude étaient l’âge, le niveau d’éducation, la religiosité et l’identité politique.
génétique et vaccins
Les questions de l’enquête se sont concentrées sur la génétique et les vaccins, car l’étude a été menée pendant la récente pandémie de COVID-19.
L’enquête a révélé qu’avant la pandémie, la plupart des gens faisaient confiance à la génétique. Et cette confiance dans la génétique avait considérablement augmenté après la pandémie.
L’enquête a également interrogé les participants sur la vaccination contre le coronavirus (les vaccins sont apparus au Royaume-Uni 5 mois avant l’enquête). Et il a découvert que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner étaient convaincus de choses qui n’avaient aucun fondement scientifique.
confiance injustifiée
Les résultats suggèrent qu’il est important que les gens aient confiance en leurs connaissances afin d’avoir une opinion solide sur des questions scientifiques d’une grande pertinence personnelle et sociale, mais que cette confiance n’est pas toujours justifiée.
Face à cette situation, les chercheurs déconseillent de discuter des convictions fermées que les gens ont sur les questions scientifiques et que, s’il y a une opportunité, il est préférable de révéler ce qui a été scientifiquement prouvé sur n’importe quel sujet, avec l’espoir que les personnes concernées s’ouvriront à la réalité
Référence
Les personnes ayant des attitudes plus extrêmes envers la science ont confiance en leur compréhension de la science, même si cela n’est pas justifié. Cristina Fonseca et al. PLOS BIOLOGY, 24 janvier 2023. DOI : https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001915